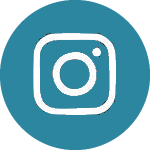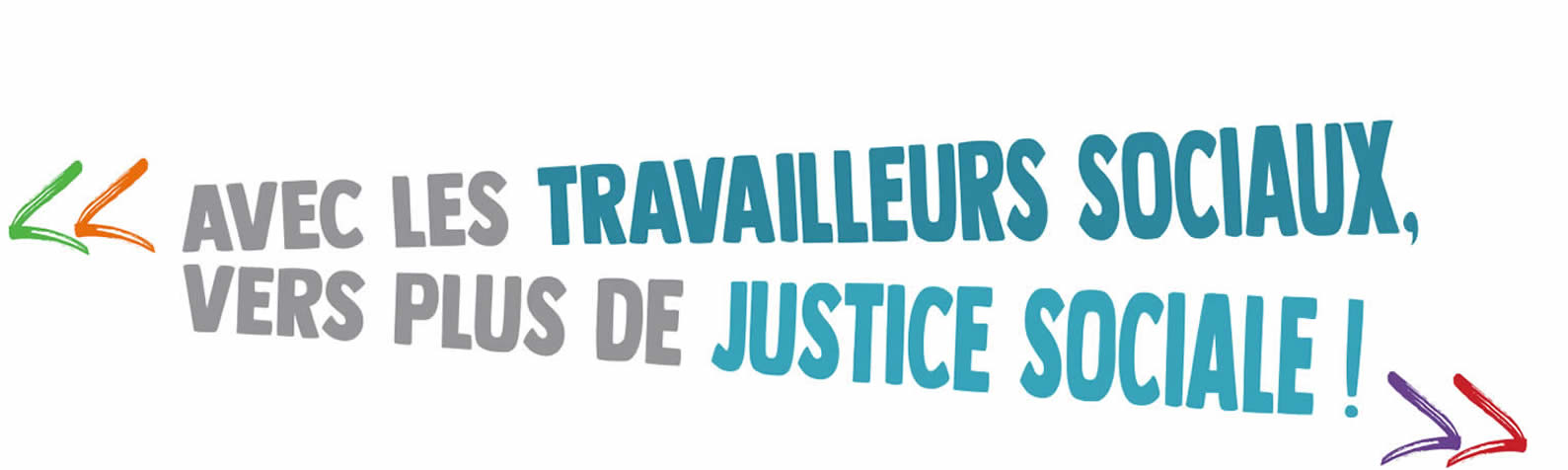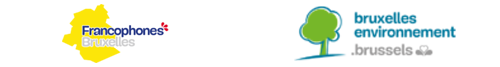Recherches
Les activités de recherche se situent dans le champ de la sociologie de l’action sociale. Elles portent sur les enjeux liés aux politiques sociales, à l’intervention sociale et aux conditions de vie des personnes précarisées.
Retrouvez toutes les publications en lien avec les recherches ci-dessous sur cette page.
Travail social
« Cette recherche, menée en collaboration avec l’UMons, l’UCLouvain, l’Araph et l’ULiège et commanditée par l’ONE, porte sur les accompagnements des parents porteurs d’une déficience mentale et intellectuelle, en en particulier les mères. La multiplicité des intervenant-es et des services gravitant autour de ce public spécifique (sociaux, relevant des soins de santé, judiciaires, sécuritaires, etc.), les rôles et missions endossés par les différents acteurs (notamment dans leur dimension contraignante ou pas), l’intérêt supérieur de l’enfant, les cadres de convention et de collaboration, etc. constituent des nœuds potentiels qui entravent la mise en place d’accompagnements cohérents fondés sur la confiance et la collaboration entre le public et les professionnel-les.
Une méthode d’analyse en groupe (MAG) organisée et animée par les chercheuses de la FdSS en automne 2022 et rassemblant des professionnel-es de terrain a mis a jour ces différentes tensions et a permis la co-construction d’une analyse du travail de proximité auprès de ce public et l’énonciation de recommandations pour l’action publique.
Cette MAG s’est inscrit dans un protocole de recherche plus large, impliquant d’autres méthodologies (quantitative et qualitative) et aboutissant à un rapport de recherche collectif, présenté à des réseaux d’acteurs professionnels relevant de différentes sphères et disciplines. »
Depuis sa mise en place fin mars 2020 en réponse aux fermetures imposées par le contexte sanitaire, le numéro vert bruxellois a fait l’objet d’un travail d’évaluation mené par la cellule recherch’action de la Fédération des Services Sociaux en collaboration avec les services partenaires du numéro vert – à savoir des Centres d’Appui aux Personnes (CAP) et des Centres d’Action Sociale Globale (CASG) de la Région bruxelloise[i].
L ’ensemble des constats sur l’aggravation des situations de précarité en région Bruxelloise amène à se demander en quoi et comment le numéro « Allo ? Aide sociale » est une réponse pertinente pour les personnes en difficulté. Cela revient à décrire les contours du métier de répondant·e, à identifier les fonctions qu’il remplit ou ne remplit pas, et la manière dont il s’inscrit dans un système d’aide sociale fortement affecté par le contexte de crise. Le travail d’analyse et d’évaluation mené avec les répondant-es a permis de définir les aspects bas-seuil, inclusif et anonyme du dispositif « Allo ? Aide sociale », de modéliser et baliser ses différentes modalités d’intervention au départ de l’échange téléphonique, de penser sa place et son rôle spécifique parmi les autres 0800 actifs sur la région bruxelloise et plus globalement, au sein du paysage social bruxellois.
Par ailleurs, le numéro « Allo ? Aide sociale » fait l’objet de bilans périodiques réguliers portants sur le nombre et le type d’appels reçus au numéro vert, jouant en cela un rôle de thermomètre des difficultés sociales vécues par les Bruxellois-es.
[i] Le Centre de Service Social Bruxelles Sud-Est, Brabantia – SS Cureghem, Les Amis d’Accompagner, Espace P…, Solidarité Savoir, le Service Social Juif, le Centre d’Accueil Social Abbé Froidure (Les Petits Riens), le Centre Social Protestant, Wolu-services, l’Espace Social Télé-Service, les Services Sociaux des Quartiers 1030, Brabantia – Caritas International, CAW Brussel;
Cette étude nous a été confiée par le Centre d’Appui – Médiation de Dettes (CAMD) qui organise depuis 2005 des ateliers de prévention du surendettement. L’objectif de l’étude était de prendre du recul sur cette pratique, de mettre en perspective les questionnements qui la traversent et de rendre visible ce que les participant∙e∙s disent en retirer.
Les analyses proposées s’appuient sur un dispositif de recherche de type « compréhensif ». Cette démarche s’intéresse au sens que les individus ou organisations donnent à leurs pratiques. Les données ont été produites au travers de l’observation de huit séances d’ateliers menées dans quatre organisations différentes, suivies systématiquement d’un entretien de débriefing avec les animatrices ; de quatre demi-journées d’analyses collectives avec l’équipe du CAMD ; et enfin, de douze entretiens approfondis menés auprès de participant∙e∙s aux ateliers et de professionnel∙le∙s des organismes commanditaires.
Quels sont les nœuds et tensions dans l’accompagnement vers l’accès aux droits des personnes qui ont une activité prostitutionnelle ?
Projet de recherche-action débuté en mars 2019, financé par l’«Association des Fonds Sociaux Fédéraux et Bicommunautaires (FE.BI)» (2019-2021).
Objet de la recherche : pratiques et nœuds du travail social avec des personnes prostituées
Les associations d’aide aux personnes prostituées sont confrontées à des difficultés nouvelles dans la mise en œuvre de leurs missions sociales et de prévention : diversification des contextes et des profils de prostitution, problématiques migratoires, durcissement des politiques de répression de la prostitution de rue, nouveaux canaux de prostitution (2.0), etc. Ces changements viennent interroger les travailleurs sociaux dans leurs pratiques d’accompagnement, notamment dans l’aide à l’accès aux droits (en matières de santé, de logement, d’éducation, etc).
Le projet souhaite approfondir ces questionnements avec les travailleurs sociaux (à Bruxelles et en Wallonie) et en dialogue avec les parcours d’accès aux droits des personnes prostituées.
Objectif : identifier et renforcer les conditions nécessaires aux travailleurs sociaux pour fournir un accompagnement de qualité
- Rendre visible la façon dont les travailleurs sociaux exercent leur travail et dans quelle mesure les cadres d’action actuels permettent, à leurs yeux, la mise en œuvre d’un accompagnement pertinent ;
- Enrichir les travailleurs sociaux et mettre au travail avec eux les nœuds de l’accompagnement sur base des récits de l’expérience des prostitué.e.s ;
- Rendre visible la mécanique de (non-)accès aux droits des personnes prostituées au regard des cadres juridiques et politiques en matière de prostitution ;
- Proposer des lignes d’action concrètes pour renforcer les services et les travailleurs de l’aide aux personnes prostituées ;
- Créer, avec les acteurs de terrain, une production artistique « participative » qui, d’une part, soutient l’« échange de savoirs » et l’appropriation des résultats de recherche par les travailleurs sociaux et, d’autre part, permet de rendre visible à un public large, les tensions auxquelles leur travail les confronte.
Méthode : une recherche participative avec les acteurs de l’aide sociale aux prostitué.e.s
Le projet de recherche a été construit sur base d’une rencontre préalable avec les associations membres de la FdSS travaillant auprès de personnes prostituées, afin de prêter une oreille attentive aux questionnements et difficultés des travailleurs sociaux dans leurs pratiques d’accompagnement. Des enjeux multiples ont émergé et constituent le socle de ce projet de recherche-action.
La recherche a été réalisée selon une approche qualitative (entretiens, observations/immersions dans le travail social, méthode d’analyse en groupe) auprès des travailleurs sociaux et des personnes prostituées. Elle a été en outre soumise aux ajustements propres à la méthode de recherche participative, en mobilisant les associations dans l’analyse et la diffusion des résultats. Cette méthode permet l’enrichissement des travailleurs sociaux non seulement par les résultats de l’analyse, mais aussi par leur participation au processus même de la recherche et l’échange/dialogue entre les savoirs issus de leur expérience de terrain et ceux des chercheurs.
Contacts :
lotte.damhuis@fdss.be
Cahiers de la Recherch’action issus de cette recherche :
Damhuis L., Maisin C. (2022). «Prostitution et accès aux droits – La portée démocratique du travail social», Les Cahiers de la recherch’action, n°11, Bruxelles : FdSS.
Consulter
Damhuis L., Maisin C. (2022). «Prostitution et accès aux droits – La portée politique du travail social», Les Cahiers de la recherch’action, n°11, Bruxelles : FdSS.
Consulter
Outil : Jeu de carte pour les intervenants de terrain
Enjeux éthiques dans le champ de l’intervention sociale : quelles préoccupations, analyses et stratégies des intervenant(e)s ?
Recherche internationale collaborative coordonnée par l’AIFRIS (Association Internationale pour la Formation, la Recherche et l’Intervention Sociale)
La recherche « Enjeux éthiques dans le champ de l’intervention sociale : quelles préoccupations, analyses et stratégies des intervenant(e)s ? » est coordonnée par l’Association Internationale pour la Formation, la Recherche et l’Intervention Sociale (AIFRIS) et se déroule dans quatre pays francophones (France, Suisse, Canada et Belgique). Son but est d’identifier les points communs ou au contraire les aspects spécifiques des enjeux, préoccupations et problèmes éthiques qui se posent aux intervenants sociaux dans ces différents contextes nationaux.
Le groupe thématique « éthique » de l’AIFRIS définit les concepts clefs de sa problématique comme ceci :
« Par préoccupation éthique, nous entendons un trouble, un malaise qui peut concerner une situation particulière, un mode de fonctionnement habituel (dans une pratique, en lien avec une politique, avec certaines logiques d’intervention, etc.), une décision à prendre, et qui met en jeu des valeurs, des questions de sens. Par problème éthique, nous entendons un conflit de valeurs entre différentes manières de mener une intervention sociale, ou, plus largement, une absence de solution évidente face à un problème engageant des conséquences importantes pour soi, pour autrui, et/ou pour une collectivité. Cela peut concerner plus spécifiquement un conflit entre normes organisationnelles /institutionnelles /professionnelles /déontologiques, ou entre normes et valeurs, entre principes et conséquences, entre valeurs et intérêts en jeu ; une tension entre généralité d’un principe et singularité d’une situation ; ou encore un manque de repères normatifs pour résoudre un problème inédit, une absence de réponse institutionnelle par rapport à une situation spécifique ou à des besoins récurrents, etc. » (AIFRIS – Groupe thématique Ethique, « L’éthique en action dans le travail social : une recherche collaborative comparée », Présentation du projet pour les partenaires, 20 novembre 2015, p.2 et 3.)
Démarche méthodologique
Une approche méthodologique commune – s’inspirant de « la méthode d’analyse en groupe [MAG]*» librement adaptée à d’éventuelles contraintes locales – est utilisée pour recueillir la parole et l’expertise de travailleurs sociaux au contact de différentes problématiques et/ou publics dans chacun de ces pays. Les groupes de professionnels constitués pour contribuer à ce travail sont nommés Groupes Locaux Ethiques (GLE).
La MAG, conçue par Van Campenhoudt et al. (2005) consiste à partir de témoignages concrets apportés par les participants (des « récits » directement issus de leurs réalités de travail et révélateurs d’une problématique particulière), pour construire une analyse collective à travers l’organisation des multiples interprétations qu’ils produisent et ainsi, d’accroître la compréhension des difficultés qu’ils rencontrent dans leur profession et de mieux en saisir les enjeux.
*Pour une présentation détaillée mais sommes toute plus synthétique de cette méthode, voir : Van Campenhoudt L., Franssen A. et Cantelli F., 2009
Contribution de la FdSS : « éthique, travail social et santé mentale »
Dans un premier temps, la contribution de la FdSS se situe plus particulièrement dans l’axe croisant travail social, enjeux éthiques et santé mentale. Une session d’intervision (deux matinées) a été organisée autour de ce thème par sa cellule recherch’action dans un double objectif :
- Dans une perspective de production de connaissances : Apporter une contribution belge à cette recherche internationale collaborative
- Dans une logique « d’intervision » : Proposer aux assistants sociaux participants des moments de partage d’expériences entre professionnels, de prise de recul et de construction d’analyses collectives, qui leur permettent d’accroître leur compréhension des difficultés rencontrées lorsque des problèmes de santé mentale s’introduisent dans leur réalité de travail.
Rapport issu de cette recherche : Serré A. et Ayadi A., « Le travail social au contact de personnes souffrant de problématiques de santé mentale », Rapport d’intervision, FdSS, septembre 2017. Disponible sur demande.
 La recherche intitulée Regards croisés : usagers et travailleurs sociaux a débuté en mars 2013. Cette recherche a été financée par l’«Association des Fonds Sociaux Fédéraux et Bicommunautaires (FE.BI)» pour une durée de deux ans. Des financements complémentaires ont, par ailleurs, été attribués par les cabinets des Affaires Sociales COCOF, COCOM et wallon.
La recherche intitulée Regards croisés : usagers et travailleurs sociaux a débuté en mars 2013. Cette recherche a été financée par l’«Association des Fonds Sociaux Fédéraux et Bicommunautaires (FE.BI)» pour une durée de deux ans. Des financements complémentaires ont, par ailleurs, été attribués par les cabinets des Affaires Sociales COCOF, COCOM et wallon.
Première partie : regards d’usagers
Les années 2013 et 2014 ont été consacrées au recueil de la parole des usagers afin d’analyser leurs perceptions du travail social en général et, plus spécifiquement, la façon dont ils vivent l’accueil et les services qui leur sont offerts par les centres membres de la FdSS-FdSSB. 107 entretiens ont été réalisés dans 23 salles d’attente de services sociaux associatifs bruxellois et wallons, mettant au jour la diversité des regards et des expériences vécues.
L’équipe de recherche a présenté une première série d’analyses à l’occasion de la journée de « Zoom sur l’action sociale », le 17 février 2014. En parallèle, la cellule recherche, Cécile Hupin, Guillaume Istace et le CBCS ont inauguré l’espace scénographique « Paroles d’usagers » : cette création offre une entrée plus artistique, traduisant autrement l’intimité des usagers, leur parcours et leur rapport aux services sociaux.
Deuxième partie: retour vers les professionnels (en cours)
D’octobre 2014 à avril 2015, nous avons organisé des groupes de travail au sein de chaque centre ayant participé à la recherche. Fondé sur une démarche de co-construction de savoirs entre praticiens et chercheurs, le dispositif d’animation proposait d’associer les travailleurs sociaux à l’analyse des données récoltées, sur base de leur point de vue particulier de professionnel, d’une part, et du contexte spécifique de leur centre, d’autre part.
La diffusion des résultats de la recherche
Les cinq premiers volumes de la revue « Les Cahiers de la Recherch’action » se consacrent à la diffusion des résultats de cette recherche. Privilégiant un contenu synthétique, accessible et mobilisable par différents types d’acteurs (les professionnels de terrain, les décideurs politiques,…), chaque numéro de cette série approfondit une thématique spécifique, à la croisée des analyses produites par les professionnels et des perceptions des usagers des services.
Aide alimentaire
« Solidarité en primeur(s) » (Solenprim) – Vers de nouveaux rapprochements entre le secteur de l’aide alimentaire et les systèmes d’alimentation durable à Bruxelles
[2016-2018]Financée par Innoviris (l’Institut bruxellois pour la recherche et l’innovation), la recherche-action participative « Solidarité en primeur(s) », dite Solenprim, a débuté en janvier 2016 pour une durée de trois ans. Elle se fixe l’objectif général de formaliser de nouveaux rapprochements entre le secteur de l’aide alimentaire et les systèmes d’alimentation durable à Bruxelles.
Menée suivant un principe de « co-création », elle rassemble différents partenaires : La FdSS (qui coordonne le projet au travers l’implication de sa Cellule recherch’action et de la Concertation Aide alimentaire), le Centre Social Protestant (CSP), La Porte Verte / Snijboontje et Snijboontje bis, l’épicerie sociale du CPAS d’Ixelles, l’épicerie sociale du CPAS de Berchem-Sainte-Agathe et la plateforme d’achats solidaire Soli-Food.
Le projet et les objectifs visés
Le projet Solenprim s’est élaboré autour des objectifs opérationnels suivants : créer, développer et évaluer des dispositifs ou initiatives pilotes permettant aux publics les plus précaires d’accéder durablement à une alimentation de qualité, saine, diversifiée, et d’être connectés à des systèmes alimentaires alternatifs qui promeuvent de nouvelles formes de solidarités, de coopérations et d’échanges. Il s’agit aussi d’élaborer des dispositifs qui permettent aux organismes d’aide alimentaire de s’associer davantage à cette transition vers des systèmes d’alimentation durable.
Enjeux de connaissance et question de recherche
La question de recherche principale est la suivante : En quoi et comment des dispositifs innovants, associant le secteur de l’aide alimentaire à la transition vers un système alimentaire durable, sont-ils susceptibles d’accroître durablement la liberté de choix et le champ des usages alimentaires des publics défavorisés ?
Cette question principale s’articule en trois types de questions connexes :
- Des questions opérationnelles et stratégiques directement liées aux objectifs généraux visés par les partenaires du projet, comme par exemple : Comment connecter durablement les publics précaires à ces systèmes d’alimentation durable ?
- Des questions de recherche proprement dites, relatives aux réalités des bénéficiaires de l’aide alimentaire, aux réalités du secteur ou encore au suivi, à l’analyse et à l’évaluation des dispositifs innovants qui seront co-créés par les partenaires, etc.
- Des questions de « méta-recherche », centrées sur le suivi et l’analyse du processus de co-création lui-même et de ses enjeux.
Calendrier de travail
Dans l’esprit de la co-création, c’est avec les bénéficiaires de l’aide alimentaire et les travailleurs salariés et volontaires du secteur, que :
- Dans un premier temps (« les racines des difficultés »), nous diagnostiquerons le poids des contraintes qui réduisent les capacités d’accès à une alimentation variée et les possibilités d’usages variés des aliments.
Outils : méthode Ishikawa, diagnostics locaux, transversaux, croisés et « world-smoothies ».
- Dans un second temps (« des branches aux solutions »), de façon prospective, nous imaginerons différents dispositifs à privilégier pour réduire le poids de ces contraintes, accroître les possibilités de choix alimentaires des personnes défavorisées et promouvoir des usages différenciés des fruits et légumes. Ce travail prospectif sera mené avec l’appui d’acteurs périphériques susceptibles d’apporter un soutien utile (associations agricoles, Mabru, etc.).
Outils : méthode d’extrapolation rétrospective et travail en « charrettes ».
- Dans un troisième temps (« la récolte »), nous implémenterons ces dispositifs pilotes au sein des associations partenaires et nous évaluerons leurs limites et leurs bénéfices respectifs avec les acteurs concernés.
Outils : méthode de suivi et évaluation participatifs (SEP) et méthode d’analyse en groupe (MAG).
- Transversalement, les aides alimentaires étant généralement octroyées pour une durée limitée, nous nous intéresserons aussi au caractère durable des dynamiques et changements initiés à travers le suivi de cohortes de bénéficiaires.
Liens :
Débutée en septembre 2014, la recherche « L’aide alimentaire aujourd’hui, le droit à l’alimentation demain » vise l’actualisation des données d’une précédente étude menée par la FdSS[1] sur l’aide alimentaire à Bruxelles. Cette dernière avait permis de dresser un état des lieux du secteur, essentiellement, au départ du point de vue des acteurs de terrain ; cette nouvelle recherche s’est centrée davantage sur le regard des bénéficiaires.
Fruit d’une collaboration entre les cellules Aide alimentaire et Recherch’action de la FdSS, cette recherche répond à plusieurs objectifs, déclinés en différentes phases :
Dresser un état des lieux actualisé et affiné de l’aide alimentaire à Bruxelles
Début 2015, la cellule Aide alimentaire a recueilli, auprès des organismes d’aide alimentaire, des informations factuelles (localisation, horaire, nombre de personnes aidées,…) qui :
- d’une part, constituent une cartographie interactive destinée à faciliter les dons adressés aux organisations d’aide alimentaire. Sur celle-ci, les organismes (publics et associatifs) d’aide alimentaire sont localisés: en cliquant sur un organisme, une fiche apparaît, reprenant en synthèse des informations utiles pour les donataires potentiels (véhicule disponible, besoins en denrées, jours d’ouverture,…).
- d’autre part, fournissent des données quantitatives sur les moyens logistiques, les publics et les associations du secteur de l’aide alimentaire à Bruxelles : ces données viendront directement alimenter le rapport présentant les résultats de la recherche en cours.
Accroitre les connaissances disponibles sur les bénéficiaires des services d’aide alimentaire
De mars à mai 2015, les chercheurs sont allés à la rencontre des bénéficiaires au sein de six organisations d’aide alimentaire (colis, épiceries sociales, restaurants sociaux). En tout, 32 témoignages d’usagers ont été recueillis.
L’analyse des entretiens réalisés a permis de questionner, entre autres, leur parcours, le rapport qu’ils entretiennent au dispositif d’aide alimentaire, aux professionnels, aux autres usagers, ou encore, la manière dont ils appréhendent la fin de l’aide alimentaire.
Engager une réflexion collective entre les acteurs du secteur
A l’occasion d’un premier groupe de travail, organisé le 15 janvier 2015, la Cellule Recherch’action de la FdSS s’est réunie avec six professionnels du secteur. Cette rencontre a permis de préparer la phase des entretiens qualitatifs de la recherche, en tenant compte de l’expertise et des préoccupations des acteurs de terrain.
En juin 2015, les chercheurs ont organisé et animé quatre autres séances de groupe de travail avec des travailleurs et bénévoles du secteur de l’aide alimentaire et des représentants de CPAS, afin de poursuivre la production d’analyses collectives.
Les enseignements de cette recherche ont été publiés sous plusieurs formes : un rapport de recherche (consultable sur demande); Un numéro des Cahiers de la Recherch’action ; un article paru dans le N° 75 de la revue Santé conjuguée.
[1] La recherche-action sur les réalités de l’aide alimentaire à Bruxelles, menée par la FdSS-FdSSB entre mars 2007 et février 2009, a fait l’objet d’une publication en février 2010 : HUBERT, H.-O., NIEUWENHUYS, C., 2010, L’aide alimentaire, au cœur des inégalités Logiques sociales, L’Harmattan, 180 p.
Recherche-action concernant les possibilités intégrantes et activantes de l’aide alimentaire en y associant ses bénéficiaires d’une manière active
Ce rapport est le résultat d’une étude visant à mettre en lumière les possibilités d’intégration et d’activation de l’aide alimentaire par l’implication active des usagers.
En effet, l’aide alimentaire est toujours nécessaire en Belgique dans la lutte contre la précarité.
Cette étude offre une connaissance d’un secteur jusque-là assez méconnu du grand public et des médias. Elle tente d’identifier les limites et les effets positifs d’une participation des bénéficiaires de l’aide alimentaire. Les trois objectifs principaux de cette enquête sont :
- D’offrir un aperçu du secteur de l’aide alimentaire et de son fonctionnement participatif;
- De présenter une série de pratiques participatives innovantes dans les trois Régions du pays;
- De proposer une analyse des obstacles, conditions et effets d’une aide alimentaire axée sur l’émancipation et de la capacitation.
Cette étude a donné lieu à une publication en mai 2012.
Les initiatives qui encouragent une participation des bénéficiaires de l’aide alimentaire sont minoritaires (participation au niveau manutention, distribution, ateliers ou activités collectives, formations…). Pourtant, la participation des usagers est sans nul doute une perspective à explorer si l’on veut que l’aide alimentaire contribue davantage à l’émancipation des usagers, d’une part, et conforte la promotion du droit à une alimentation adéquate et durable, d’autre part. Cependant, elle n’en reste pas moins difficile à concrétiser. Cette étude aborde cette question au travers de projets-pilotes de participation dans des associations d’aide alimentaire.
Cette étude a donné lieu à une publication en janvier 2012.
Globalement, le secteur de l’aide alimentaire est actuellement très éclaté. Les épiceries sociales sont des projets compliqués à pérenniser, pour des raisons diverses : difficultés d’approvisionnement, de gestion de stocks, de viabilité financière, de personnel… Face à ce constat, l’objectif de cette étude était de chercher à rassembler les épiceries sociales pour :
- favoriser l’échange des informations et des bonnes pratiques
- améliorer la logistique et le financement
- soutenir la création de nouveaux projets d’épiceries sociales ou de projets d’économie sociale au sein d’épiceries sociales existantes.
Cette étude a donné lieu à une publication en novembre 2010.
Recherche-action sur les réalités de l’aide alimentaire à Bruxelles
Etat des lieux des centres de distribution de colis, des restaurants sociaux et des épiceries sociales. Qui sont-ils, comment fonctionnent-ils, dans quel cadre professionnel, avec quels travailleurs, quel travail social, où trouvent-ils les denrées, qui sont les bénéficiaires de ces centres… autant de questions auxquelles cette étude tente de répondre.
Energie
Etude des conditions de possibilité d’extension d’une réponse associative à la question de l’accès à l’énergie aux secteurs de l’aide sociale en Région de Bruxelles-Capitale
Depuis 2009, « le service énergie (SE) de la FdSS-FdSSB a été testé, adapté et amélioré afin de proposer une méthodologie et une expertise efficace dans le domaine de la guidance sociale énergétique.»1
Plus de trois années d’expérience, la satisfaction des ménages suivis des Accompagnateurs Energie qui réalisent ce suivi et des services sociaux partenaires, confirment l’intérêt et la pertinence de l’offre. Aujourd’hui, il convient de penser son avenir et son développement.
Actuellement porté par 4 ETP de terrain et 1,5 ETP de coordination, et en partenariat avec deux uniques secteurs de l’aide sociale (les CASG et les CAP), le SE ne peut inévitablement répondre qu’à un nombre limité de demandes. Or, le potentiel dans ces deux secteurs, mais aussi dans d’autres secteurs qui proposent un accompagnement social de première ligne, est probablement important.
« Bruxelles Environnement souhaite à présent implanter plus largement ce projet afin de répondre aux demandes pouvant émaner d’autres secteurs sociaux associatifs. »2 Si ces secteurs peuvent proposer une réponse à la fois efficace et pertinente à des problèmes d’accès à l’énergie, en complémentarité avec les acteurs déjà présents, c’est un champ qu’il vaut la peine d’investir.
« Grâce à son expérience et à sa bonne connaissance institutionnelle, la FdSS, en tant que fédération d’associations siégeant dans plusieurs conseils consultatifs, propose une investigation des besoins spécifiques des secteurs et des meilleures manières, en tenant compte des caractéristiques de chaque secteur, de proposer à leurs bénéficiaires un service en matière d’énergie. Cette investigation et la construction de pistes, étant donné le nombre de secteurs potentiellement concernés à Bruxelles, est un travail de recherche à part entière. »3
A cet effet, un projet de recherche a été présenté par la cellule énergie de la FdSS à l’IBGE et au Cabinet de la Ministre de l’Energie. Depuis le 1er novembre 2012, et ce pour une durée de trois années, un chercheur de la FdSS est chargé de l’étude des conditions de possibilité d’extension du SE.
Dès la proposition de la FdSS d’étendre le service énergie à d’autres secteurs de l’aide sociale à Bruxelles, la volonté était claire. Cette extension n’aura de raison d’être qu’à la condition d’être développée au travers de partenariats et/ou de collaborations avec les acteurs déjà présents en matière d’accès à l’énergie en Région de Bruxelles-Capitale.
Au travers de la recherche, nous tenterons de comprendre en quoi l’offre du service énergie se distingue, s’imbrique et se veut complémentaire des missions en matière d’accès à l’énergie des CPAS et des (futures) Maisons de l’Energie Huis.
1 Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement (IBGE), Appel d’offres général E12-345, cahier de charges concernant la mise en œuvre d’un service d’accompagnement social en matière d’énergie par des travailleurs sociaux en Région de Bruxelles-Capitale, 27/04/2012.
2Idem.
3 Fédération des services sociaux – Fédération des services sociaux bicommunautaires (FdSS-FdSSB), Soumission – Offre de services en réponse à l’appel d’offres Appel d’offres général E12-345, cahier de charges concernant la mise en œuvre d’un service d’accompagnement social en matière d’énergie par des travailleurs sociaux en Région de Bruxelles-Capitale (Document interne).
Autres
D’un long processus de concertation inter-sectorielle est issue une recherche-action sur le thème de l’évaluation qualitative. Proposant une réflexion collective et structurée à une douzaine de secteurs de l’action sociale et de la santé, cette démarche a mis en évidence l’intérêt d’une méthode de concertation systématique, associant tous les acteurs de l’évaluation à la définition des objectifs poursuivis et des critères retenus pour la mener à bien.
Cette étude a été publiée dans la revue BIS (Bruxelles Informations Sociales), n°156. Le BIS est téléchargeable ici, depuis le site du CBCS, éditeur.
Outreach
Recherche-intervention financée par la Cocom
Depuis décembre 2021, la Cellule recherch’action est engagée dans l’accompagnement et l’analyse d’un dispositif d’intervention sociale de quartier, le BRI-Co, qui a pour but d’encourager la mise en place d’actions concrètes d’amélioration de la qualité de vie de certains territoires bruxellois dits « relégués ». Il constitue en ce sens une double opportunité d’agir sur les enjeux de l’accès aux droits et aux services (Noël, 2016) et de favoriser une redynamisation des démocraties locales [Renvoyer à la page consacrée au projet].
Ce projet de recherche relève de la « sociologie de l’intervention », à savoir : « une pratique spécifique de la discipline conduisant le sociologue à s’immerger, sur (auto)sollicitation, dans une microsituation, afin d’en proposer une lecture dont les effets (de contenu ou de processus) pourraient participer d’une transformation de ladite situation » (Herreros, 2001, p. 273). Concrètement, en tant qu’intervenant∙e∙s chercheur∙e∙s, nous sommes amené∙e∙s à remplir plusieurs rôles qui se nourrissent respectivement :
- Documentation et production de données empiriques à partir de plusieurs méthodologies de recherche (entretiens informels et semi-directifs, observation participante, Méthode d’Analyse en Groupe, etc). Ce travail se réalise à différents niveaux. Dans le cadre des trois jours de BRI-Co, nous collectons la parole des habitants des quartiers fréquentés, sur les « réparations » (changements) à entreprendre dans leur milieu de vie ou plus spécifiquement sur une thématique définie en amont (la santé physique et mentale, la précarité alimentaire, etc.). Les récits ainsi récoltés sont mis au service des actions menées à l’échelle des territoires. En les additionnant, ils permettent également d’établir une vue d’ensemble sur les problématiques rencontrées dans les quartiers précarisés de la région bruxelloise. Par ailleurs, nous documentons le dispositif « en train de se faire », via un système d’archivage d’observations multiples et d’écrits (compte-rendu de réunions, restitution des BRI-Co, mails, etc.). Nous avons aussi mené des entretiens semi-directifs ainsi que des groupes d’analyse collective (sous forme de MAG) avec une série d’acteurs impliqués dans le projet.
- Gestion concrète du projet et facilitation de divers espaces de réunion.
- Production de méta-analyse sur le dispositif et ses effets. Partant des données recueillies, nous analysons les effets concrets du BRI-Co tant dans le sens restreint de l’action concrète qu’il permet de mettre en œuvre, que dans le sens large des dynamiques individuelles et collectives qu’il contribue à impulser. Ces analyses sont inscrites dans une réflexion plus large sur les enjeux et les défis politiques que posent les dispositifs participatifs à destination de personnes éloignées de la parole et de l’action publiques, d’une part et, d’autre part, le processus de territorialisation des questions sociales, tout particulièrement dans un contexte généralisé de défiance envers les autorités publiques.
En 2021, dix-huit travailleur·euses sociaux, appelé·es Relais d’Action de Quartier (RAQ) ont été déployé·es dans des quartiers bruxellois concentrant des difficultés socioéconomiques et des indices de population fragilisée avec pour mission de renforcer l’accessibilité aux services sociaux et de soins, et de lutter contre le non-recours aux droits. Financé par la COCOM et coordonné par la FdSSb, ce projet s’inscrit aujourd’hui au sein du Plan Social Santé Intégré, qui a pour objectif de réduire les inégalités socio-spatiales présentes sur le territoire bruxellois au travers de la mise en place d’une organisation territoriale de l’offre social-santé au plus proche des besoins locaux.
La posture adoptée par les RAQ, appelée « aller-vers » ou outreach, est un type d’intervention sociale qui a pour principe de sortir des murs de l’institution pour aller à la rencontre des publics éloignés des politiques sociales et de santé publique, et ainsi s’extirper du rapport qui peut s’exercer de part et d’autre d’un guichet. La spécificité du projet est d’articuler cette posture de l’aller vers avec un travail à l’échelle du quartier.
Depuis ses débuts, le projet RAQ intègre un processus de recherche-action nourri par les théories de la sociologie de l’intervention, à savoir : « une pratique spécifique de la discipline conduisant le/la sociologue à s’immerger, sur (auto)sollicitation, dans une microsituation, afin d’en proposer une lecture dont les effets (de contenu ou de processus) pourraient participer d’une transformation de ladite situation » (Herreros, 2001, p. 273). Le rôle des chercheur.euses au sein du projet est de soutenir les travailleur·euses de terrain dans leurs pratiques et dans la construction de leur métier, et de nourrir la réflexion autour des enjeux-clés du projet.
Démarche méthodologique
- TRAVAIL COLLECTIF: Le déploiement des RAQ sur le terrain a soulevé diverses questions quant à ce nouveau métier « en train de se faire ». Une matinée par semaine est dédiée à soutenir la réflexivité des RAQ sur leurs pratiques et leurs missions mais aussi, sur la vision au fondement du projet. Les chercheureuses y animent des intervisions, des groupes de travail autour de thématiques spécifiques ainsi que des séminaires de réflexion à partir d’un texte ou autres ressources théoriques qui peuvent aider à penser certaines questions (aller vers, approche territoriale, non-recours, travail social communautaire, etc.).
- SUIVI INDIVIDUELS: Chaque RAQ est suivi par un.e chercheur.euse afin de documenter le travail qu’il∙elles mènent sur leur terrain à travers des observations participantes et des entretiens individuels. Lela chercheur·euse peut également apporter un soutien méthodologique au·à la RAQ dans la mise en œuvre de ses projets.
- JOURNAL DE BORD: Chaque RAQ rempli un journal de bord en ligne permettant de documenter les actions et projets menés.
- FAIRE DES PONTS: L’équipe de recherche nourrit également le projet en faisant des liens avec d’autres initiatives et espaces de réflexion (séminaires, conférences, colloques, groupes de réflexion), portés par la FdSS ou d’autres acteurs, en lien avec le travail social, l’approche territoriale, les inégalités de santé, le non-recours aux droits, etc.
LIENS
- Site du projet : https://www.raq.brussels/fr/
- Cahier de la recherche #14 « Aller vers à l’échelle d’un territoire. Le projet des Relais d’Action de Quartier »
- Document balise du projet
- Rapport de recherche 2021